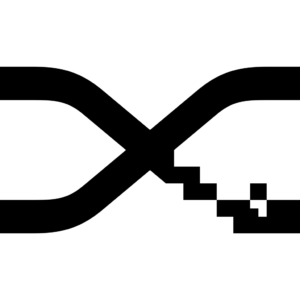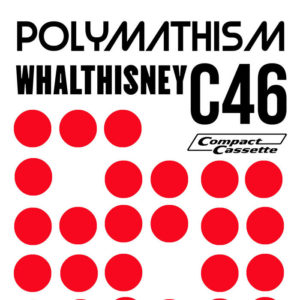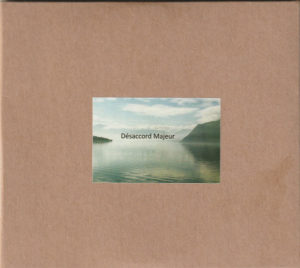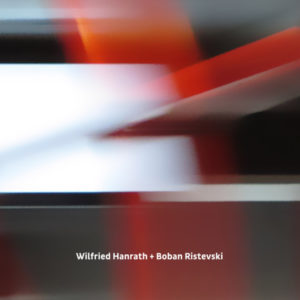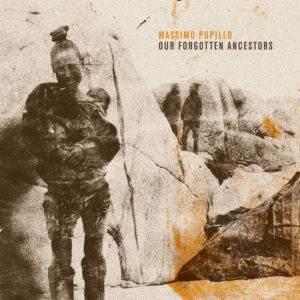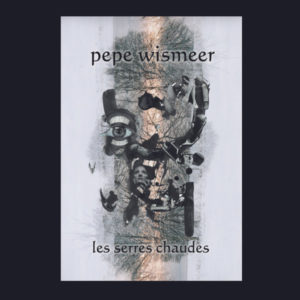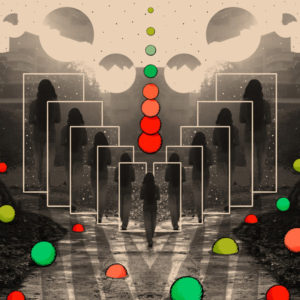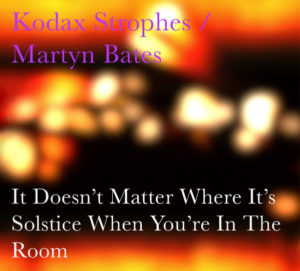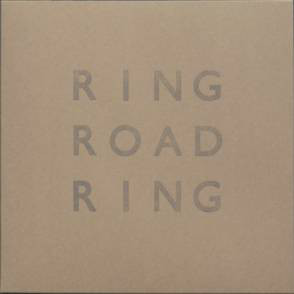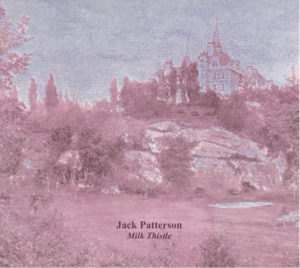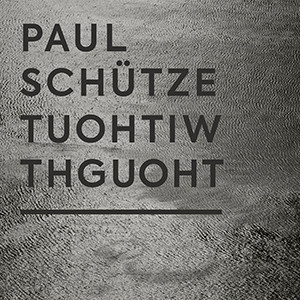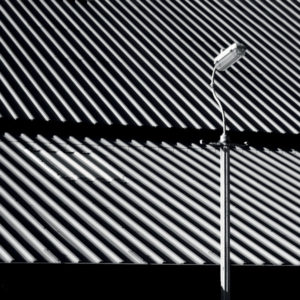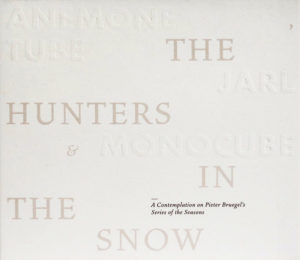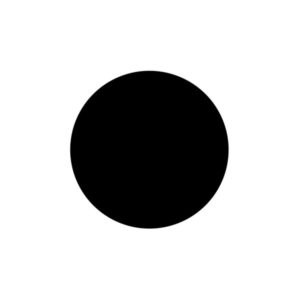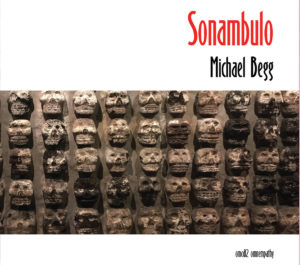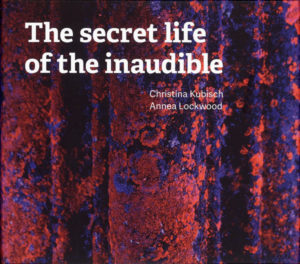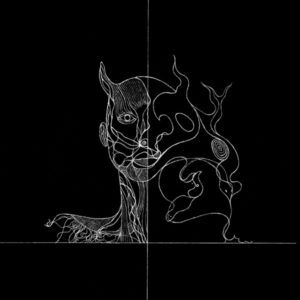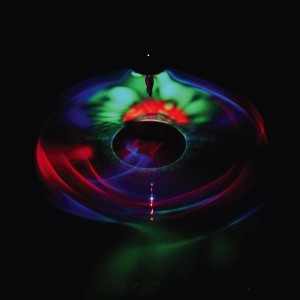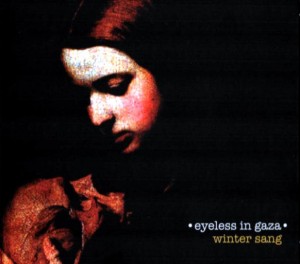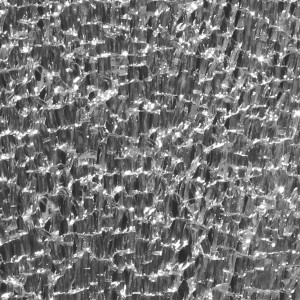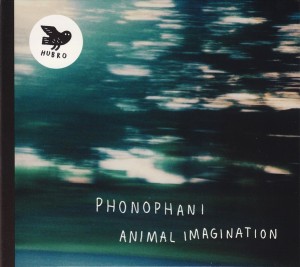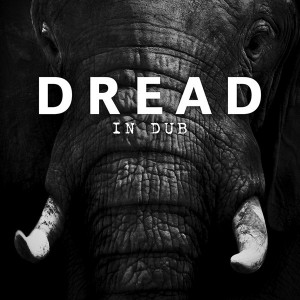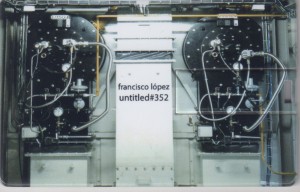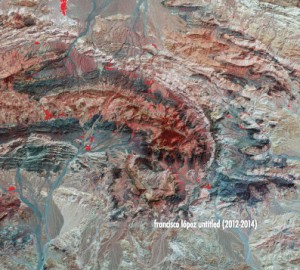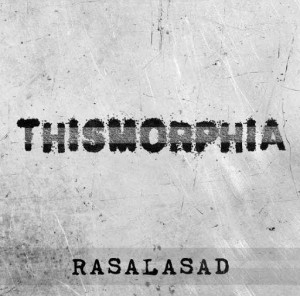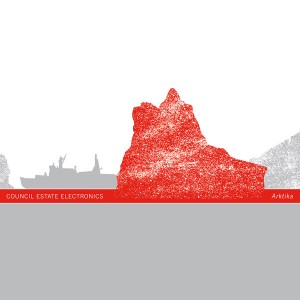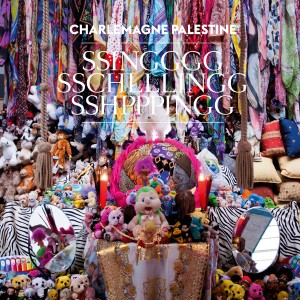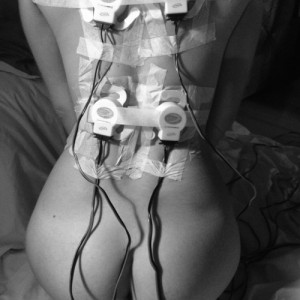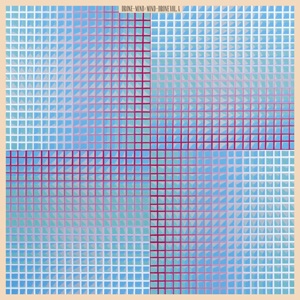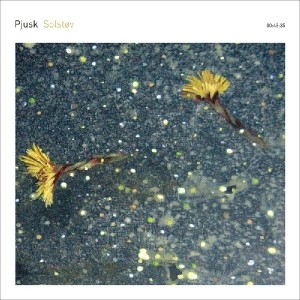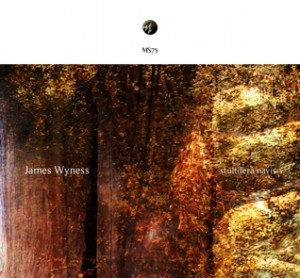Polydor
https://shopfr.songsofalost.world/
« …le monde arrêté figé s’effritant se dépiautant s’écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée, inutilisable, livrée à l’incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps. »
Claude Simon, La Route des Flandres
Disintegration paraissait destiné à rester le dernier chef d’œuvre de The Cure, même si nous n’avions sans doute pas pris la mesure de son importance en 1989 – nous avions vingt ans –, et il a fallu périodiquement jeter un regard rétrospectif pour apprécier son caractère monumental.
Comme Eric Draven, le héros de The Crow (The Cure a signé avec Burn l’un de ses meilleurs morceaux des années 1990), Robert Smith semble tirer sa force de son affliction. Le spleen, le chagrin, la mélancolie, que sais-je encore, tout cela serait-il le meilleur moteur de l’énergie créatrice de Robert Smith ? C’est un cliché, gravé dans le marbre depuis le premier romantisme, mais les albums piliers Seventeen Seconds / Faith / Pornography témoignent en sa faveur.
À ceci près que le jeune homme de vingt-trois ans chantait « It doesn’t matter if we all die », et qu’aujourd’hui oui, la mort est grave.
En 2022 avec le début de la tournée « Shows Of A Lost World », il était évident que l’album à venir serait différent des enregistrements quasi insignifiants qui avaient suivi Disintegration. Dès la première date, à Riga, deux nouveaux morceaux étaient dévoilés, Alone en introduction et Endsong pour conclure le premier set, positionnement qui ne doit rien au hasard. L’attente du nouvel album devenait exaltante, en raison de la sombre beauté que Alone et Endsong promettaient, bien plus que pour combler une absence discographique de seize ans.
« This is the end of every song we sing », ce sont les premières paroles de Alone, qui ouvre très naturellement cet album, Songs Of A Lost World. Des paroles qui surviennent après une introduction instrumentale de plus de trois minutes – trop longue jugeront certains – qui permet à mon sens de mener la musique à son point de pression atmosphérique nécessaire, une densité portée par la réverbération et surtout par le contrepoint devenu une donnée fondamentale dans les compositions de Robert Smith au cours des années. Car non, il faut se faire une raison, The Cure n’est plus minimaliste. En cela déjà Songs Of A Lost World répond davantage à Disintegration qu’à Faith.
Alone donne aussi le ton général de l’album par son texte. C’est déjà une Endsong : « La fin de toutes nos chansons ». La fin aussi des rêves, des espérances, c’est un effondrement des illusions propres ou partagées ; et l’on ne peut se prévenir de penser ici au récent album d’Eno Foreverandevernomore. Tout s’effondre dans Alone, les oiseaux, les mots, l’amour.
Songs Of A Lost World est donc un long chant d’affliction : solastalgie, vieillissement, angoisse de la guerre, mais aussi les douleurs personnelles de Robert Smith. Le jeune homme s’obsédait d’une vision romantique de la mort. L’homme âgé a vu la mort prendre corps ou plutôt les voler ; la perte de sa mère puis de son frère a fait la mort éminemment présente.
Ces chants parcourent ainsi un monde perdu, l’arpentent et en définissent la géographie, le relief, les reflets. Répétons : Alone ouvre l’album quand le long Endsong le conclut et reprend le motto « The end of every song » (emprunté au poème Dregs d’Ernest Dowson). L’un se reflète dans l’autre, le boucle. Songs Of A Lost World débute donc sur une fin et s’achève sur le néant.
Le deuxième morceau And Nothing Is Forever trouve ses symétriques dans les deux avant-derniers, le très émouvant I Can Never Say Goodbye et le très « Cure-classic » All I Ever Am. Quant aux deux morceaux centraux Warsong et Drone:Nodrone – le dernier de la face A et le premier de la face B si l’on considère l’édition en vinyle – ce sont les deux compositions les plus épaisses, les plus ouvertement rock (Push et The Baby Screams étaient positionnés de la même façon sur The Head On The Door).
Et l’on ne peut s’empêcher encore de comparer Songs Of A Lost World à son devancier Disintegration. Tout d’abord par sa coloration musicale, par la mélancolie qu’il porte, par la place importante qu’y trouve dans l’instrumentarium la basse Fender VI établissant sa densité dans l’atmosphère crépusculaire. On pense aussi le parallèle qui peut être construit entre certains morceaux. A Fragile Thing par exemple, et c’est un sentiment éprouvé dès son écoute, dès que les paroles s’entendent, tient la place que Lovesong occupait dans Disintegration, chanson d’amour en léger décalage avec le reste de l’album. Même rythme. Mais quand Lovesong s’entendait comme un épithalame, l’archétype de la déclaration d’un amour éternel, A Fragile Thing en décrit la matérialité corruptible, la désillusion. Et c’est exactement la façon dont Robert Smith commente ce titre à la sortie de la vidéo, « la plus puissante des émotions […] et dans le même temps la plus fragile ». Portée par une belle ligne de basse, la chanson incite au déhanchement dans la tourmente. Plus loin Drone:Nodrone semble se donner la place qu’occupait Fascination Street, avec un son plus dur. Mais la régularité de ce dernier ne parcourt pas Drone:Nodrone qui dans ses riffs (le guitariste Reeves Gabrels y est trop bavard) s’entend comme plus proche du single de 1990, Never Enough.
L’autre morceau le plus dur, Warsong, est bien plus intéressant. Il hypnotise par son léger motif flûté mais surtout il donne à l’album la même tension centrale que Alone en inaugurale et Endsong en finale. Warsong cristallise de façon magistrale l’influence que The Cure a pu avoir sur la scène « shoegaze metal », et s’entend comme le feed-back de la façon dont Aidan Baker / Nadja ou Justin Broadrick / Jesu ont pu s’inspirer de The Cure, jusqu’à en enregistrer des reprises. À cela près que Robert Smith y pose un chant sans effet, plein de jeunesse jusqu’à rappeler curieusement sa démo de Mouth To Mouth dans The Glove en 1983.
Si les guitares habitent constamment chacune des huit chansons de l’album, deux autres instruments marquent particulièrement leur présence, le piano fréquemment utilisé en motif d’introduction, soulignant la mélancolie, et la basse de Simon Gallup jouée majoritairement avec une importante distorsion. C’est aussi pour Gallup une mise en lumière avec des lignes de basses complexes, très présentes, portant souvent la mélodie et participant pleinement au contrepoint, jouées volontiers en accord, plaqué ou délié. C’est un point important qui contribue pleinement à la densité musicale. Car l’affliction n’est pas synonyme de fragilité.
La nostalgie semble ici la plus présente des mélancolies, c’est un rappel incessant à ce qui n’est plus. Elle regarde ce que le temps a rongé. Smith a chanté le regret de l’innocence (Primary), il s’est parfois projeté en vieil homme (Sinking), aujourd’hui il en éprouve la réalité dans All I Ever Am et Endsong, et son regard se porte sur ce qui a disparu comme sur ce qui n’a jamais pu se produire. Il fait chanter le souvenir de ce qu’il y a de plus ancien en lui, c’est-à-dire le jeune homme (pour l’homme fait c’est l’enfant qui est ancêtre), et se demande comment il est « devenu si vieux », la mort de ses proches rendant plus évidente sa propre précarité. Et la dynamique dissolvante déjà à l’œuvre dans la trilogie glacée s’exprime très clairement : « I’ll lose myself in time, it won’t be long » (Endsong).
La déclinaison de ces thèmes au long des huit titres n’est pas simplement littéraire, elle est en parfait accord avec la musique, et la très grande qualité émotionnelle de ce groupe est retrouvée, comme au temps de Faith. Une musique portant les larmes dans un regard qui ne fléchit pas.
Nous ne savons pas ce que seront d’éventuels prochains albums de The Cure. Mais pour l’heure ces Songs Of A Lost World résonnent en nous comme le chant d’un monde retrouvé.
Denis Boyer