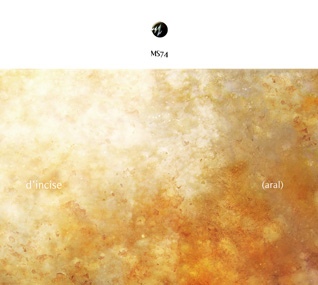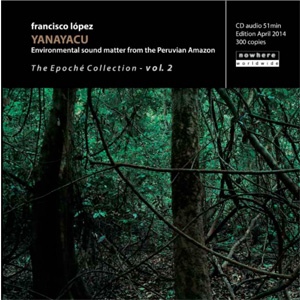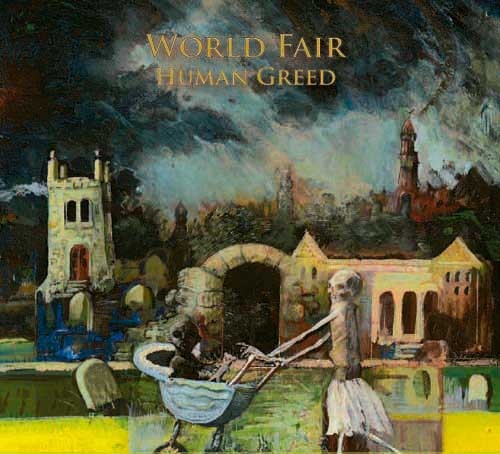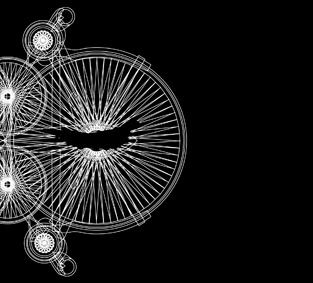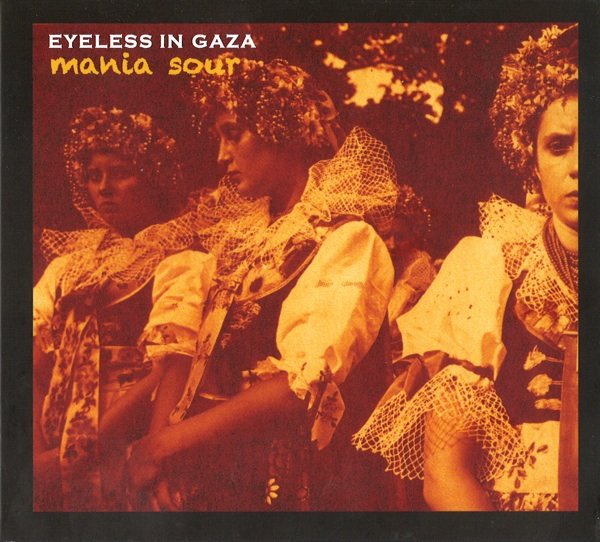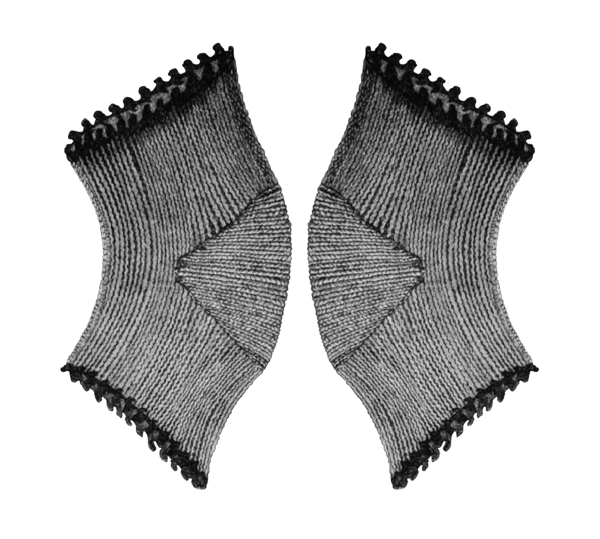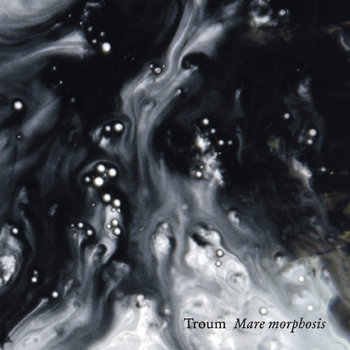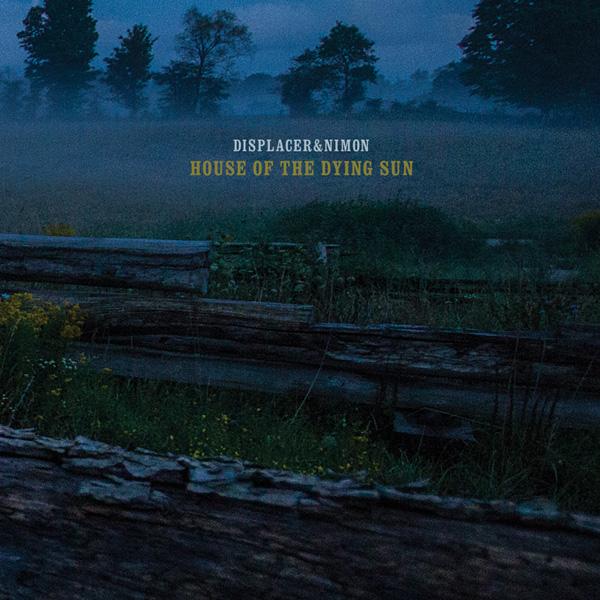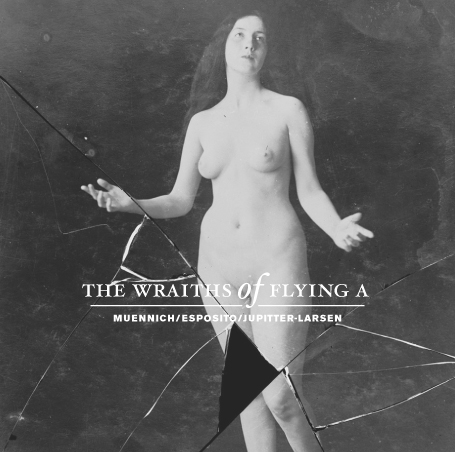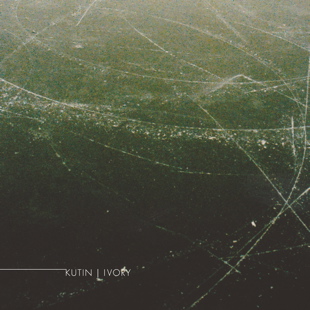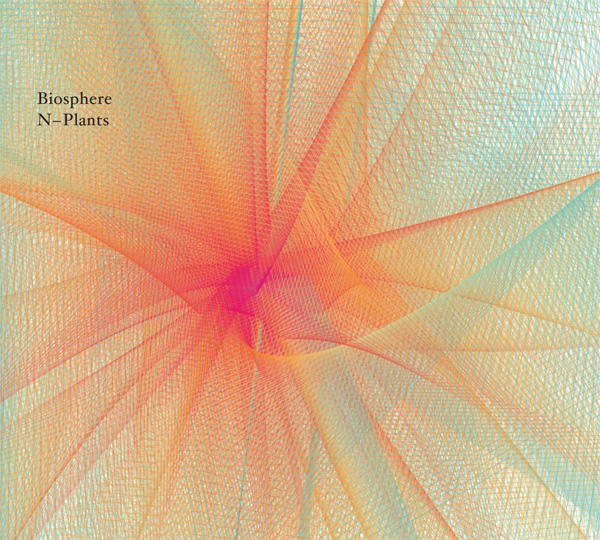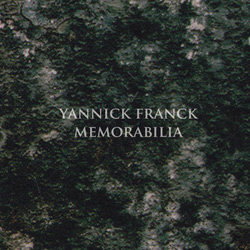Tentacles of Perception Recordings
Tentacles of Perception Recordings
www.artificialmemorytrace.com
Unfathomless
www.unfathomless.net
On n’a peut-être pas assez, dans chaque approche critique de la musique de Slavek Kwi / Artificial Memory Trace, pris l’angle de sa recherche, suivi le moteur de son travail, à savoir la perception envisagée comme prépondérante dans le rapport que l’esprit entretien avec le réel. Cette perception qui, selon certains neurologues, laisserait une trace biologique dans le système nerveux, un engramme qui témoignerait physiquement du processus d’expérience ou d’apprentissage. Changeons « biologique » par « artificiel », et le projet accordé au pseudonyme prend valeur de manifeste artistique autant que de terrain d’expérimentation. C’est ce qui depuis plus de vingt ans constitue le cœur du travail de Slavek Kwi. Qu’est-ce qu’une trace de mémoire « artificielle » ? La trace physique s’imprimant dans le cerveau (si tant est qu’elle existe) et l’adjonction à cet effet de nanoparticules, appartenant encore au domaine de la science-fiction, il convient d’appréhender le concept de manière métaphorique. Qu’est-ce qui construit de façon artificielle une relation à l’expérience, sinon sa restitution par des canaux filtrés, sa fixation par le choix d’éléments généralement significatifs et dont la présence peut-être amoindrie, effacée, ou magnifiée et transcendée, en un mot l’art ? Les pièces sonores de Slavek Kwi s’entendent alors comme la restitution du souvenir « choisi », recomposé, à la façon de l’évolution du rêve dans quoi seules certaines parties de la réalité empirique sont reflétées, hypertrophiées, distordues. Edités sur le propre label de Slavek Kwi, Tentacles of Perception, deux mini-CD exposent les résultats de cette démarche couplée à celle du travail collaboratif. Le premier, Collaboration 2009-2012 en compagnie de Linda O’Keeffe, musicalise des sons du quotidien, boucle des résonances, met en rythme un surgissement de clarté, comme peut parfois le faire Lionel Marchetti. Les deux pièces ont été finalisées par chacun des deux musiciens, tout à tour ; sur cette démarche onirique, on voit peu de différence : chaque fois des sons non musicaux, environnementaux, prennent un nouveau sens comme matière qui les révèle à une autre instance sans les dénaturer, mais en leur accordant telle prépondérance, en les isolant ou au contraire en les amalgamant. C’est un travail qui, s’il n’est que trop rarement habité par la grâce musicale, porte le projet expérimental de Slavek Kwi : comment les sons laissent-ils une trace en nous, jusque où cette trace conditionne le retour à une nouvelle expérience, comment un son domestique devient-il partie d’une orchestration concrète, comment gagne-t-il un double statut puisque jamais son ontologie n’est oubliée… Minimalisme souvent, babillage et miroitement sur vagues clames constituent les vaisseaux du voyage en zone de recyclage expérimental. Un autre travail, en compagnie de Simon Whetham sur un double mini-CD, semble quant à lui constituer tout autant réellement que métaphoriquement, un aboutissement de cette démarche. Les sons, à force de naviguer, finissent par s’imprégner du sel qui les effleure, de se dégrader, et la complexe chimie qu’ils subissent, fait oublier la trace de leur origine pour faire apparaître celle de l’évocation picturale de leur nouvelle construction. « Enfin » autonomes, ces rescapés du traitement, de la récupération et de l’altération, suivent des voix bourdonnantes, voire de fragiles vagues nappées, mais aussi des grésillements ondulés, des frottements. On regrettera que ces phases ne soient pas plus longues, chacune, et que leur transition ne se fasse pas avec plus de douceur, car elle nuit à la fixation de la perception. Le rêve sait aménager des passages insensibles, et ce n’est pas toujours le cas ici. C’est le principal reproche que l’on pourra adresser à cette évolution circulaire, tantôt métallique, tantôt minérale.
Sur le label belge Unfathomless, branche de Mystery Sea, Artificial Memory Trace revient « en solo », pour Garik Gunak Barlu, un CD où se succèdent trois compositions naturalistes (ici basées sur des phonographies réalisées en Australie) que Slavek Kwi affectionne. Les sons produits par les animaux, comme chez Jana Winderen, sont pour lui une source inépuisable d’émerveillement et de potentiel à révéler, à rehausser. La première, Breakdown, construit sa trace autour de chants d’oiseaux, d’eau, de vent. Je dois le dire, c’est ce type de compositions que je préfère dans le travail d’AMT. Peut-être parce qu’elles reprennent à leur compte des éléments qui s’orchestrent en symphonies naturelles, et que leur grain donne le ton primaire de toute construction musicale, au point que notre oreille les reconnaît pour modèles de l’art des sons. Élaborer un tableau sonore à partir des éléments collectés dans un milieu, mais également des souvenirs qu’il a laissés, et du rapport affectif qui en a levé. Dans Breakdown on progresse comme au cœur d’un couloir, une arche dont le peu de lumière que l’on perçoit à son extrémité n’effraie pas car c’est une musique nocturne, où les sons d’animaux se fondent en même tissu étoilé. Lorsque le couloir débouche, c’est sur une luxuriance mesurée, une exploration à ras de sol. La discrétion des sons d’animaux fragiles ne contraste pas avec les interventions plus tonitruantes d’oiseaux colorés, les deux types d’appels font partie d’un monde où les gravités s’équilibrent entre le haut et le bas, où les dimensions ne s’opposent pas mais se reproduisent à différentes échelles. Coralreef, la deuxième pièce, transcrit, comme son nom l’indique, une expérience de littoral. Des vagues, lentes et apaisées, portent l’écoute, et comme l’on dérive nonchalamment en baignade, font croiser divers chants d’oiseaux. À quelques mètres du rivage débute, ainsi qu’une exploration de grotte, l’affrontement en aveugle de micro-sons dont les plus ténus semblent presque mécaniques. La faune timide qui a fourni le matériau répond à une autre inquiétude : la palpitation batracienne de crépitements d’uranium – le diable est dans le détail. Nocturnalabyss, qui conclut le disque, poursuit la conversation insectoïde, cette fois aux bornes de la perception, ce qui informe particulièrement le projet de Slavek Kwi, qui a redimensionné les infimes échanges, aux limites de l’ultrason, poursuivis et mêlés aux sonars des chauves-souris et aux « aboiements » des geckos. C’est une pièce aventureuse, pas la plus intéressante d’un point de vue musical, ce qui la situe dans les parages des expériences de ses récents CD collaboratifs. Elle fascine tout de même par sa qualité visuelle, la trace imaginative qu’elle imprime et qui entraîne parfois l’esprit à concevoir des formes abstraites, curieusement éloignées des contours et des couleurs des animaux qui les ont émises.
Denis Boyer
2014-09-17